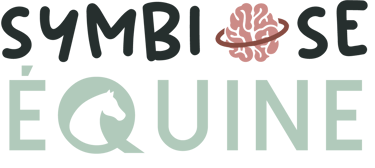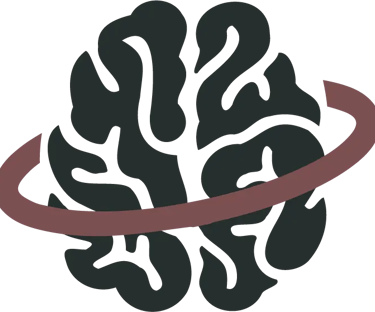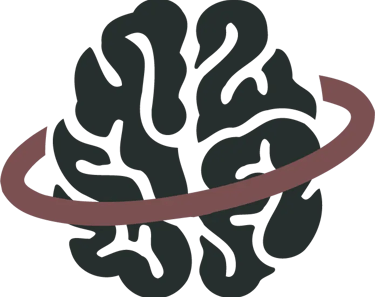4 choses que les chevaux m’ont apprises sur les relations humaines
Comment être au contact des chevaux peut aider à avoir de meilleures relations avec les gens, et avec soi-même.


Le cheval, c’est trop génial… si on prend le temps d’apprendre d’eux !
Bon, ok, les chevaux ne sont pas des gens… et les gens ne sont pas des chevaux. Mais les humains ont développé une longue histoire avec les chevaux, et il s’y joue à mon sens des schémas relationnels et des dynamiques qui peuvent nous aider à être de meilleurs humains de manière générale.
C’est d’autant plus enrichissant que les chevaux ne parlent pas, ce qui nous oblige à nous questionner, à nous mettre dans une posture de curiosité et à enchaîner les essais-erreur pour avancer dans la relation sans prendre les choses aussi personnellement qu’avec les humains.
En somme, c’est un pas de côté par défaut qui offre un angle de vue frais sur les relations.
1/ Une relation se construit dans le temps long, et il n’y a pas de raccourci
Enfant, j’aimais tous les poneys instantanément parce que… c’était des poneys ! Une logique qui se tient tout à fait quand on a 7 ans. Moins quand on est une adulte vaccinée qui paie des impôts. j’ai d’ailleurs payé cher cette adoration sans limite le jour où je suis tombée sur le poney de concours du centre, au caractère trop trempé pour moi, qui m’a fait remettre en question ma passion de l’équitation (parfois, on ne régule pas fort-fort les émotions et les imprévus à 7 ans).
En effet, aimer un poney ou un cheval juste parce que c’est un équidé, c’est finalement aimer non pas son individualité, mais sa catégorie de “poney”. Cette généralisation empêche la création d’un lien authentique et unique.
La solution : rentrer dans la nuance (la fameuse !). En effet, savoir que c’est un poney aide à communiquer avec lui correctement, à avoir la bonne posture, les bonnes attentes, etc. Mais cela ne doit pas se faire au détriment de son individualité (Gallopin préfère peut-être les pommes aux carottes). Et découvrir l’autre (comme se connaître soi-même), cela ne se fait pas du jour au lendemain. Le temps permet de construire une relation solide, ou au contraire de faire l’expérience de l’autre dans des conditions variées pour en avoir une image la plus représentative possible.
C’est donc perdre du temps pour en gagner, et surtout se laisser le temps de tâter le terrain et de changer de poney (ou d’humain) si au final on se rend compte que cela ne nous correspond pas. Cela vaut aussi pour soi : il faut laisser le temps à l’autre pour qu’il découvre qui l’on est, petit à petit, en fonction de la confiance que nous avons en l’autre et dans la relation et de son évolution.
Bref, le temps ne fait pas tout, mais il reste un outil formidable pour des relations saines et solides.
2/ Laisser les gens venir vers soi en respectant leur rythme, c’est perdre du temps pour en gagner
Curieusement, cette deuxième leçon m’est venue quand je faisais un stage de psychologie en milieu pénitentiaire psychiatrique, et quand j’avais proposé en parallèle de m’occuper d’une jument qui n’était presque jamais manipulée par l’humain. Quel est le point commun entre cette jument et un patient-détenu, me direz-vous ? L’approche. La trèèèèèèès longue approche, voire le recul.
Cette jument n’était sollicitée par les humains pour des choses peu sympathiques (j’ai nommé une séance de travail tous les 6 mois, des soins contraignants, le parage). Du fait, même lui mettre un licol devenait une lutte. Au lieu d’appuyer sur son bouton d’hyper-vigilance et d’hyper-réaction en m’imposant, j’ai laissé du vide entre nous. Je m’approchais et repartais sans être rentrée dans sa bulle.
Je l’habituais à ma présence, pas à mes contraintes. Et à force de laisser cet espace, et surtout en lui montrant que oui, je serai toujours là la semaine prochaine, la curiosité a pris le dessus : elle est venue vers moi ! Elle vient maintenant me voir, même si elle est à plusieurs mètres… à renfort de friandises au début, je l’avoue. On ne va pas s’empêcher d’utiliser l’appel du ventre si c’est bien cadré.
Les patients-détenus étaient aussi tellement marqués d’expériences négatives, de contraintes dues au milieu carcéral et d’une motivation dans les chaussettes, que certains étaient peu accessibles ou en fuite (si ce n’est physique, certainement mentale).
Mais comment créer du lien pour qu’ils s’investissent dans une psychothérapie imposée par la loi ? J’ai observé que certains venaient directement me voir ou me parler (d’un peu trop près d’ailleurs… illustration d’une distance trop basse et d’une dérégulation dans les scripts de relations humaines). Mais beaucoup étaient fuyants pour des raisons qui leur appartiennent.
J’ai pu échanger avec certains au cours de séances dirigées par mes superviseur·euses, en prenant une posture de présence active mais non menaçante. Cela laisse alors la place autant sonore que physique à l’autre, avec assez de silence pour qu’ils ne se sentent pas dirigés dans l’interaction.
Je ne suis pas restée assez longtemps pour observer des effets de ma posture mais je suis convaincue que, la nature ayant horreur du vide, laisser l’espace à l’autre tout en montrant une posture calme, solide et contenue, associée à une régularité et une prédictibilité, permet les premières conditions du lien.
Bref, laisser un peu de vide entre soi et l’autre, c’est laisser à l’autre la place de se positionner dans cette nouvelle relation qui se construit au milieu de nous. Sans espace, pas de construction de relation possible. C’est soit la fusion, soit l’évitement… (et cela parle beaucoup de nos styles d’attachement !).
3/ Il n’est pas nécessaire de tout savoir de l’histoire de l’autre pour pouvoir l’aider
Qui n’a jamais rencontré la route d’un cheval dont on ignore le passé ? C’était le cas du mien, qui était passé entre plusieurs mains et dont le passé était très flou. Pucé l’année où ce fut devenu obligatoire (de nombreuses années après sa naissance), j’ai donc comblé les vides pour produire du sens (car le cerveau, machine géante statistique, passe son temps à combler les trous pour pouvoir calculer ses prédictions peinard).
Je lui ai donc imaginé une naissance au fond d’une grange, pour la fille du paysan, sans maltraitance, mais avec une légère négligence. En effet, il avait de nombreuses traces de coupures sur le poitrail et les hanches, comme s’il avait été parqué dans un pré clôturé de barbelés, avec les vaches. Mais toutes ces histoires que je me suis raconté m’ont servi à moi, pas à mon cheval. Fort heureusement, nous avons pu construire une relation sans connaître son passé.
À chaque comportement problématique une solution, et si celle-ci ne fonctionnait pas, je pouvais échanger avec d’autres propriétaires et tenter autre chose. Sans diagnostic, nous avons parfois essayé longtemps avant de trouver ce qui nous convenait, mais c’est aussi ça la relation : cheminer ensemble.
J’ai d’ailleurs appris au détour des rencontres une personne qui l’avait connu monté en… Western ! Mais depuis, il s’était fait à ma main et à mes manières. Et puis, mon cheval ne connait pas mon passé non plus. Cependant, il arrive à relationner avec moi en s’adaptant à mes réactions et en ajustant les siennes.
C’est pareil avec les gens : pas besoin d’aller questionner la petite enfance pendant la première discussion pour commencer à cheminer ensemble. Heureusement ! Sinon, cela serait comme forcer la porte du passé intime, et parfois difficile (voire indicible) de l’autre, avec en prime le risque de le/la réduire à son passé. Même si ce dernier contient des clefs de compréhension, il est tout à fait possible de construire de belles relations sans. Et ce qui devra être partagé le sera en temps et en heure.
4/ Des fois, la relation ne fonctionne pas, et c’est OK
Le dernier point, et non des moindres : on ne peut pas aimer ou être aimé de tout le monde, et parfois, on ne saura jamais pourquoi ! Bon, si toute votre ville vous déteste, posez-vous des questions. Mais au niveau individuel, il y a parfois des personnalités qui ne fonctionnent pas ensemble, même si objectivement les deux personnes sont profondément bonnes et gentilles.
Cette claque, je me la suis prise pendant un voyage bénévole en Nouvelle-Zélande. Là-bas, le cheval favori du club ne pouvait pas me voir en peinture dès qu’il m’a vu. Et je dois dire que je lui ai bien rendu : on ne pouvait pas se sentir. Pourtant, j’aime les chevaux, il aime les humains. Mais là, impossible de fonctionner ensemble sans tension. Pourtant, cela roulait avec tous les autres chevaux et humains de l’écurie.
J’ai donc décidé d’accepter cet état de fait, de ne pas forcer la relation (de toute manière cela aurait sonné faux et empiré les choses), et nous avons cohabité dans une joie relative et sans coup de sabot. J’appelle ça une victoire.
D’ailleurs, nous pouvons aussi sans le savoir provoquer un désamour (“ce cheval me rappelle le poney qui me faisait tomber petite”) ou à l’inverse un biais positif (“ce cheval ressemble à ma DP quand j’étais ado”) et influencer sans qu’on s’en aperçoive la construction de la relation. Ce cheval m’a peut-être ramené à un autre cheval avec qui cela c’était mal passé. Du côté du cheval, mon attitude résonnait peut-être négativement dans son histoire et donc il se protégeait en étant hostile.
Avec les personnes, vous pouvez rencontrer quelqu’un qui a une voix et une attitude proche de votre meilleure amie, ou alors d’une ancienne collègue que vous aviez en horreur. Et là, sans s’en rendre compte, on retire ou on donne des points relationnels à l’autre, sans qu’il le sache ! Mais les autres vous le font aussi sûrement. Donc si quelqu’un vous regarde de travers, vous avez peut-être juste la même voix que son horrible mono d’équitation de son stage de l’été 2008… On ne saura jamais !
En bref, parfois les relations ne marchent pas sans qu’il y ait de coupable. Et accepter ça, c’est s’économiser pour pouvoir mettre de l’énergie et du temps dans les relations qui nous correspondent vraiment, sans garder de la colère envers celles et ceux avec qui ça n’a simplement pas collé.
Et vous, qu’est-ce que votre relation avec les chevaux vous ont appris sur les relations avec les humains ?
Agathe Nobis
À cheval entre la neuroscience et la psychologie, je suis maintenant en relation à distance avec Kabour, un hongre de 26 ans, après plus de 10 ans de vie commune. Kabour a littéralement changé mon rapport à mes émotions. C’est cette relation, ainsi qu’une expérience en équithérapie en Nouvelle-Zélande, qui m’ont poussé à reprendre mes études entre psychologie clinique et recherche scientifique.




Parce que le stress peut nous empêcher d'avoir des relations harmonieuses avec nos chevaux, Symbiose Équine propose un programme en 17 leçons :
Ne soyez plus envahi·e par le stress !